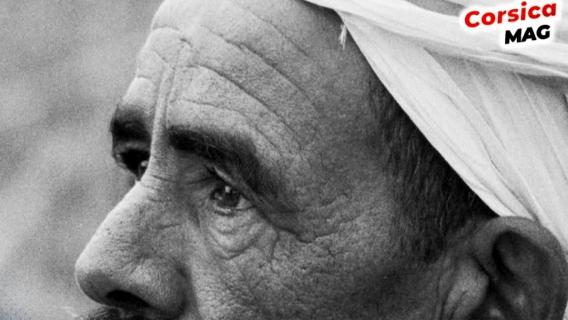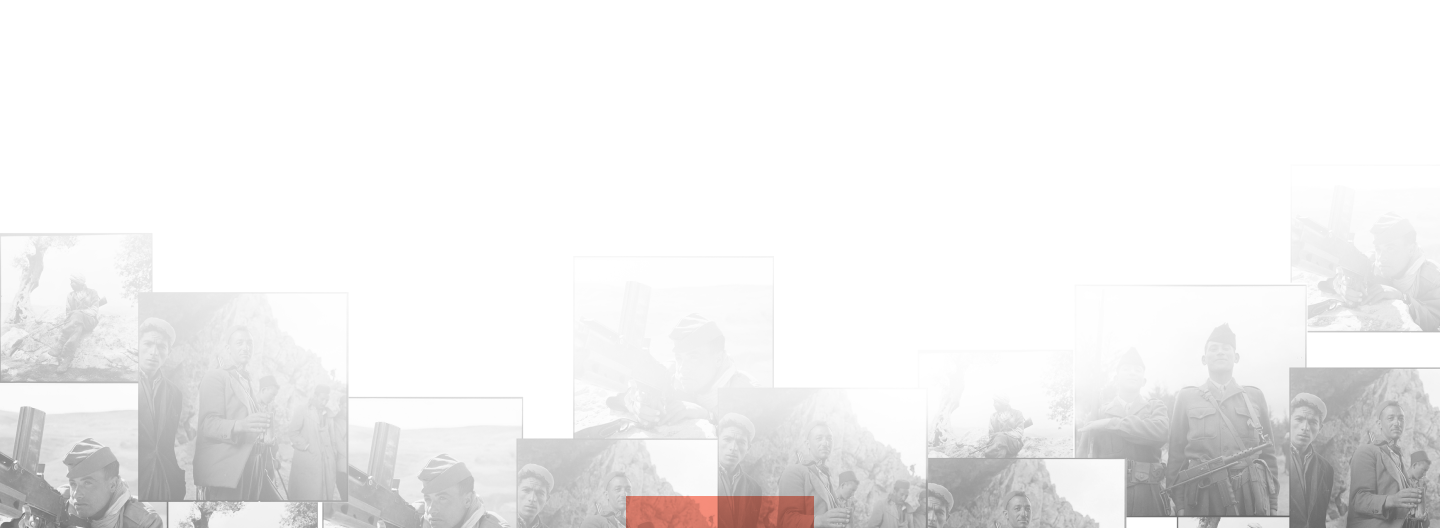Youtube - À la Croisée des Mémoires : les Harkis et la Cité royale - Réalisation Michel Talata, 2022
Nous sommes ici dans une rue faite de
goudron, un trottoir de chaque côté. Il
fait nuit.
À l'arrière-plan, un décor antique. Une
immense colonne surplombe des
habitations et un portique.
Nous sommes quelque part entre un passé
et un présent.
À l'avant-scène, un personnage barbu aux
mains démesurément grandes.
Il se tient face à nous, la tête dans
les épaules et sur sa tête un turban.
De sa main, il tient fermement une
fourche en guise de lance.
Peut-être s'agit-il du gardien des
lieux.
Son œil en forme de croix nous indique
qu'il s'agit d'un borgne.
Sur l'autre trottoir, une couronne
royale git au sol.
Et dans le ciel, de curieux oiseaux
emportent avec eux un immense étrange
cube noir.
À sa surface, des images lumineuses
apparaissent comme projetées depuis
l'intérieur. Sur l'une des faces un
carton ancien, un tireur de cartes.
Que prétent-il lire de l'avenir,
prédire du destin ?
Sur l'autre face, on devine une scène
entre un père et son enfant.
La troisième face s'ouvre sur un
escalier en colimaçon.
Le cube noir évoque la boîte noire,
symbole de la mémoire.
Un bout de mémoire se laisse emporter,
envolé ou peut-être subtilisé malgré la
surveillance du gardien dont la vision
tronquée semble lui faire défaut.
La couronne royale au sol pourrait bien
nous apporter un indice sur l'identité
du présumé auteur du délit.
En 1830, le roi Louis Philippe, après
une victoire militaire française à
Alger, occupe le territoire de
l'Algérie.
C'est le début de l'Empire colonial
français. 132 années de colonisation
durant lesquelles tout un peuple vivra
sous domination.
Manipuler, trahir, soumettre, déporter,
exproprier, exterminer. La France devra
user de stratégies politiques et
militaires obscures pour garder
l'Algérie.
Ce même Louis Philippe, dernier roi des
Français, est aujourd'hui inhumé dans la
chapelle royale de la ville de Dreux.
Ironie du sort ou coup du destin, des
générations plus tard, des familles
originaires d'Algérie étaient accueillies
dans cette même ville.
Les hommes de cette communauté portaient
le nom de Harkis.
Au cours de la guerre d'Algérie, ces
hommes qui combattaient pour
l'indépendance de leur pays avaient par
la suite changé de camp pour s'engager
aux côtés de l'armée française contre
leurs frères révolutionnaires.
Au terme de cette guerre, les
indépendantistes en sortaient
victorieux.
Quelques mois plus tard, la nouvelle
Algérie planifiait le massacre des
Harkis, les considérant comme des
traîtres.
Certains d'entre eux avaient réussi à
fuir vers la France. L'Algérie leur
était désormais définitivement une terre
interdite.
Comment ces hommes se sont-ils retrouvés
dans le camp français ? celui du camp
adverse. Ce même camp qui les a humilié,
brisé eux et leurs ascendants sur
plusieurs générations.
Arrivés en France, les Harkis venus
avec leur famille se sont reconstitués
autour d'une cause commune marquée par
un destin tragique.
La communauté Harkis était née.
À Dreux, c'est toute une partie d'un village qui
avait fui et qui s'était réinventée avec
les mêmes familles, les mêmes clans, les
mêmes traditions sur une nouvelle terre.
Un village tribal venu d'Algérie
transplanté au cœur de la cité royale,
là où l'histoire coloniale a commencé,
là où elle s'est arrêtée sept
générations plus tard.
Les Harkis et la cité royale, un
carrefour où se croise la petite et la
grande Histoire, l'histoire d'une tribu
et l'histoire de France.
Deux parcours que tout semble opposer et
pourtant réunis dans un même lieu autour
d'un même destin à la croisée des
mémoires.
Au centre du tableau, un œil dont les
contours sont tracés à la craie. L'œil se
compose de plusieurs éléments sur
lesquels l'œil lui-même porte un regard.
L'œil et l'objet observé ne font qu'un.
Intriqués l'un dans l'autre comme deux
faces d'une seule et même pièce.
Le tableau nous invite ici à porter un
regard sur l'histoire des Harkis dans un
contexte colonial. Au-delà du clivage
opposant le colon au colonisé, le
dominant au dominé qui en définirait
seulement les contours.
Le processus qui a mené à la fabrique du Harki
trouve sa source à la frontière de
relations chaotiques entre les deux
peuples. Des relations complexes
entretissées d'alliance et de conflit et
ce depuis le début de la conquête.
En 1830, le territoire algérien est sous
domination ottomane depuis trois
siècles. C'est alors une terre faite
d'un ensemble de tribus rivales plus ou
moins soutenues par le régime en place.
Lors de sa conquête contre le pouvoir
turc, l'armée française se cherche des
alliés, des combattants auprès des
tribus. En échange de quoi, la France
leur garantit l'accès à de nouveaux
privilèges.
Les premiers combattants autochtones au
service de la France portent le nom de
Zouaves, choisis pour leur connaissance de
la culture du pays, des codes de
l'adversaire.
L'armée française cultive ainsi les
rivalités entre tribus en s'associant
stratégiquement avec les unes pour
combattre les autres. C'est en usant
d'une politique de division que l'armée
réalise sa conquête.
à l'instar du recrutement des troupes de
Spahis, puis quelques années plus tard
des tirailleurs algériens pour combattre
le reste des tribus résistantes.
La formation des troupes Harkies au cours de la
guerre d'Algérie s'inscrit dans cette
même tradition militaire.
Au centre de l'œil, l'iris et la
pupille.
L'iris est une combinaison de personnages
disposés en cercle dont l'accoutrement,
la posture, l'auréole nous indique qu'il
s'agit de figures bibliques.
À l'arrière-plan vu de haut, un cube
oblique constitue la pupille.
Le fond bleu se compose de forme
géométrique circulaire indiquant que la
scène est en mouvement.
Des silhouettes circulent autour de la
forme cubique à l'image de la marche
rituelle de pèlerin musulman autour de
la Kaaba.
L'œil se fait témoin d'une alliance
entre deux mouvements religieux
chrétiens et musulmans.
Après cette année de conflit, l'émir
Abdelkader, chef des tribus autochtones
et le général Bugeaud , chef militaire
français, signe un traité de paix. Le
traité de Tafna.
Les deux parties conviennent d'une
répartition des territoires.
Les terres intérieures du pays sont
désormais la propriété du peuple
algérien et les côtes maritimes, celles
des Français.
À l'avant du tableau, une pièce en
carton.
Sur sa surface se dessine un plan dont
la partie centrale est transpercée,
déchirée.
La faille représente symboliquement la
rupture du traité de Tafna deux années après sa
signature.
Le roi Louis Philippe ordonne la
poursuite de la conquête vers
l'intérieur du pays. L'émir Abdelkader s'y oppose.
C'est le retour à l'état de guerre.
Le général Bugeaud a désormais pour
objectif la conquête absolue du
territoire.
Sa politique militaire de la terre
brûlée consiste à pourchasser les
résistants par une incessante offensive,
brûlant leur récoltes, incendiant leurs
villages et, s'il le faut, les exterminer.
Loin de faire l'unanimité au sein des
tribus, l'émir Abdelkader renonce à la
guerre.
Ils se rend aux autorités françaises.
Au premier plan, un personnage
recroquevillé se déplace dans les airs.
Sa trajectoire est représentée par une
succession de plans.
Une carte du monde recouvre son corps.
Le personnage est en rotation sur
lui-même. La trajectoire, elle, est
circulaire.
Tout indique qu'il s'agit là d'une
métaphore de la planète Terre en
révolution autour du soleil.
Le terme révolution prend ici le sens
d'état d'effervescence, d'agitation, de
changement.
La position fœtale du personnage annonce
un événement en gestation, une révolte à
venir.
En 1871, la défaite militaire française
contre l'Allemagne est vue comme un
affaiblissement de l'État français par
de nombreux chefs de tribus, ce qui est
pour eux l'occasion de lancer une
révolte.
Le chef de guerre, El Mokrani parvient à
rassembler plus de 250 tribus. Des
tribus conscientes des divisions du
passé sont désormais prêtes à dépasser
leurs rivalités pour la cause. La révolte
est brutale et se conclut par une
défaite des Algériens.
Au sol, un carton vide dont le couvercle
a été arraché.
Le personnage lui est comme plongé dans
un sommeil.
Sur son corps est tracé un itinéraire dont
la destination s'arrête en
Nouvelle-Calédonie.
Après leur défaite, les résistants sont
violemment réprimés. Certains sont
arrachés de leur terre, enfermés dans des
cages, déportés jusqu'en
Nouvelle-Calédonie.
Des hommes réduits à des paquets de
chair transportés au-delà des mers.
Aujourd'hui, encore des générations plus
tard, leurs descendants vivent désormais
sur ces terres lointaines.
Au-delà du sort des déportés, c'est tout
un peuple qui est sanctionné,
soumis à des travaux forcés, expropriés
de leurs biens et de leur terre.
Pour l'empire colonial, l'objectif est
clair, réduire à néant l'espoir d'une
révolte à venir. Le peuple est mis en
sommeil.
Un personnage genou à terre, la tête
baissée, le corps vouté. Il peine à se
relever.
En arrière-plan, une porte fermée.
Au mur, l'inscription du mot bas dont le
sens est inversé combiné d'une flèche
tendant vers le haut.
Au sol, l'ombre portée d'une grille
symbolise le rempart qui le sépare du
monde extérieur,
devenu inaccessible.
En 1900, des partis politiques se
forment, ouvrent les portes à un islam
politique dans le but de fédérer les
tribus autour d'un projet national
commun.
"Depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au
mouvement national algérien, sous le mot
d'ordre, la parole au peuple."
Politiquement, il revendique l'égalité
avec les Français. C'est un échec.
Les dirigeants sont condamnés,
emprisonnés.
Le gouverneur d'Algérie, Maurice
Viollette, souhaite accorder le droit de
vote à quelques milliers d'intellectuels
algériens pour apaiser les tensions.
Mais la pression des grands
propriétaires colons est significative.
Tout comme les chefs politiques
algériens qui voient d'un mauvais œil le
projet de loi, le qualifiant d'une
nouvelle tentative de division du
peuple. Le projet échoue. En 1914,
d'autres ont choisi l'engagement
militaire parmi les troupes de
tirailleurs algériens pour aller
combattre l'ennemi de l'ennemi.
Lors de la grande guerre sur le champ de
bataille, leur sang se mêle au sang des
Français. Ils espèrent des droits
légitimes grâce au sacrifice commun.
Mais en vain, au plus bas, la tension
monte.
À l'avant-scène, un taureau blessé par des
impacts de balle. Son corps est couvert
d'empreintes de mains faites de sang.
Le taureau symbolise ici le déchaînement
des instincts.
Au sol, git deux têtes séparées de leur
corps.
À l'arrière-plan, une main recouvre un
impact autour duquel se dessine une
empreinte en négatif représentant les
figures bibliques.
Il s'agit de l'œil précédemment abordé.
Le regard ici est occulté.
Le taureau fixe de son regard une scène
qui se déroule hors champ. Une scène que
nous ne pouvons voir.
Nous sommes ici dans les coulisses
clandestines et secrètes d'une guerre à
venir.
Loin des lois établies, chacun des deux
camps va se rendre coup pour coup, prêt
à user de stratégies les plus sanglantes
pour atteindre ses objectifs.
En 1945, un parfum de révolte se fait
ressentir.
L'Algérie est au bord de l'explosion.
Le 8 mai pour fêter la fin de la guerre,
un défilé est organisé.
À Sétif un homme déploie un drapeau de
l'Algérie.
Il est abattu par un policier.
En réponse, un civil européen est
assassiné.
Plusieurs émeutes et actions meurtrières
s'en suivent.
Une milice française formée pour
l'occasion commet le massacre de
dizaines de milliers d'Algériens.
C'est la rupture.
En réaction, un nouveau parti politique
algérien et sa branche armée voit le
jour, le FLN.
"Toute l'Algérie
accumulé tant de d'amertume et de
colère."
Le Front libéral national, l'objectif
visé est clair et sans ambiguïté : une
révolution illimitée jusqu'à
l'indépendance totale.
En 1954, une série d'attentats est
commise par les nouveaux
révolutionnaires.
Ces événements signent le début de la
guerre d'Algérie.
L'armée française s'implante
stratégiquement plus près de la
population, cultive les rivalités au
sein des groupes politiques algériens.
La torture devient progressivement une
arme de guerre.
Du côté algérien, des tensions naissent
au cœur de l'appareil révolutionnaire.
Les dirigeants voient des traîtres et
des espions partout.
En 1957, dans le village de Melouza,
plusieurs centaines d'Algériens sont
massacrés, soupçonnés de soutenir le
parti rival.
Un climat de méfiance, de menace, de
terreur contraignant de nombreux
révolutionnaires pris en étau à devoir
choisir entre deux camps hostiles. L'un
au nom d'un projet révolutionnaire mené
par une politique fratricide, l'autre au
nom d'un maintien de l'ordre républicain
amputé de ses valeurs.
Des dizaines de milliers d'entre eux
choisissent de s'engager au côté de
l'armée française. Ces hommes portent le
nom de Harkis signifiant en arabe
"mouvement", en somme une troupe mobile
choisie pour leur connaissance des lieux
et des codes de l'ennemi.
En 1961 coup de théâtre.
"Ne nous acharnerions certainement pas à
vouloir rester auprès de gens qui nous
rejetteraient." Le général De Gaule
annonce un État Algérien souverain à
venir. Désormais, la question du devenir
des Harkis se pose.
Nous sommes dans un cimetière
au sol des croix au nombre de sept,
éclairées par le même nombre d'étoiles.
L'ombre portée des croix forme une
échelle.
Un personnage suspendu dans les airs
s'interpose entre une lune et une
étoile, toutes deux symbolisant le
drapeau algérien.
À l'arrière-plan, l'inscription du mot
"haut" dont le sens est inversé combiné
d'une flèche tendant vers le bas.
Le fond bleu instaure une ambiance
mystique.
Une marelle est dessinée à la craie sur un
sol argileux.
Nous sommes ici quelque part entre terre
et ciel.
Le tableau représente la période de
transition qui mènera le peuple algérien
vers son indépendance.
Les négociations entre l'État français
et le FLN provoquent des troubles
internes au sein de chacun des deux
camps. Du côté français, une partie des
militaires s'opposent à la politique
d'abandon de l'Algérie. La foule n'est
pas armée, pourtant soudain en face
d'elle, des soldats tirent.
Du côté algérien, les partis politiques
mènent une guerre fratricide, se
disputant la prise de pouvoir à venir.
Au cœur de ce chaos, le sort des Harkis
et des civils européens reste en
suspend.
Au terme de la guerre, en mars 1962,
l'Algérie s'apprête à devenir
indépendante.
La France quitte progressivement son
territoire colonial.
Après sept générations, les civils
européens abandonnent leur terre,
laissant derrière eux leurs biens, leurs
morts. L'État français ordonne le
désarmement immédiat des Harkis et leur
interdit tout rapatriement vers la
France.
Les Harkis restent et représentent
aussitôt aux yeux des nouveaux
dirigeants, les frères ennemis, ceux qui
ont pactisé avec l'occupant.
Au terme de l'aventure coloniale, la
présence pour ne pas dire l'existence
des Harkis représentera aux yeux des
deux nations la trace mémorielle d'un
versant gênant de l'histoire, un versant
que l'on préfère occulter des récits
nationaux.
De l'abandon de l'État français au
massacre fratricide.
Le destin tragique de dizaines de
milliers de Harkis en sera le prix.
Le personnage en suspens surplombant le
cimetière représente le soldat Harki,
inconnu, massacré, dont le corps démembré
a été abandonné quelque part sans
sépulture entre terre et ciel.
Au premier plan, un couple planté dans
le décor.
L'homme porte un carton.
À côté, la femme se tient face à nous,
stoïque.
Sa tenue vestimentaire ornée de motifs
colorés contraste avec le fond terne du
tableau. À l'arrière, des oiseaux
tournoient au-dessus d'un immense colis
marqué par les étapes de son itinéraire.
Marseille, Rivesaltes, Choisy-le-Roi et Dreux.
Au sol, le plan d'une ville s'inscrit
tel une ombre. Des dizaines de milliers
de Harkis sont parvenus à fuir. Des
rescapés dans la tourmente, choqués par
le massacre des frères, mais aussi
traversés par le sentiment amer d'avoir
été abandonnés par l'État Français.
Les Harkis et leur famille sont parqués
dans des camps dans le sud de la France,
enfermés et encadrés militairement, loin
des villes, loin de la République.
De nombreuses familles y resteront
cloîtrées encore de longues années. En
réalité, l'État français n'était pas
prêt à les accueillir. Et puis, on
souhaite oublier la guerre, la sale
guerre et son passé colonial.
Alors, que faire des Harkis venus avec
leur famille ?
À Dreux, des immeubles sont construits pour eux
en périphérie de la ville. La guerre est
finie mais les rancœurs sont encore là.
Des conflits éclatent.
Au fil du temps, les Harkis se font
discrets. Les rancœurs se vivent à la
maison. Dehors, il faut se fondre dans
la masse. Nous sommes français et nos
enfants seront français aussi. De
nombreux enfants se voient attribuer à la
naissance un deuxième prénom, un prénom
français pour une meilleure intégration.
À l'école, on apprend l'histoire de
France. Le passé est scellé, la guerre,
la terre, les croyances ancestrales sont
passées sous silence. Il fallait oublier.
Un long chemin vers la réconciliation se
met en marche.
Un personnage recroquevillé est à l'étroit
dans un carton.
Le corps exerce une pression sur le
carton qui se déchire.
Une inscription en arabe se lit sur son
corps.
Il est écrit "aqra"
qui signifie lit, regarde, observe.
En arrière-plan sur le mur, des
inscriptions gravées. On reconnaît le
déporté abordé précédemment.
Sur la droite des bâtonnés rayés
représentant le calendrier d'un
prisonnier comptabilisant les jours qui
passent.
À gauche, un personnage tel un
marionnettiste, semble régler les
rouages, le mécanisme d'une scène qui se
joue.
Les inscriptions sont blanches sur un
mur sombre en négatif à l'image d'une
radiographie.
Ces images sortent tout droit du monde
intérieur du personnage.
Nous sommes dans son inconscient, un
inconscient qui nous donne à voir les
forces intérieures qui le régissent.
Des années se sont passées.
Les parents se sont accoutumés au code
de leur terre d'accueil. Les enfants eux
se sont acclimatés à leur identité
double.
C'est à l'adolescence que l'écart entre
la vie intime et la vie sociale s'est
fait ressentir.
La stratégie d'assimilation atteignait
ses limites.
Les enfants devenus grands s'y sentaient
à l'étroit. Le besoin légitime de savoir
d'où l'on vient pour définir le chemin
que l'on souhaite tracer.
L'histoire des Harkis ne figure pas dans
les manuels scolaires. Les pères
étaient venus de nulle part. Le silence
avait pris en otage le passé.
Un lourd secret enveloppe la communauté
Harkie et au premier rang, leurs
descendants, usés de compter les jours,
se font entendre au détriment de la loi,
au péril de leur vie.
"Écroués après les violents incidents du
weekend dernier, les enfants de Harkis
accompagnent..."
Les parents voient leurs enfants plonger
dans la violence. Cette même violence
venue du passé qu'il s'étaient pourtant
évertués à occulter derrière leur
mutisme.
Tout ce qui se tenait jusque-là se
défait. Le collectif Harkis , celui des
mères et des pères vieillissants, père
de sa contenance. Le village réinventé
vole en éclat.
Au premier plan, un personnage dont la
tenue vestimentaire évoque celle d'un
représentant religieux.
Sa posture désarticulée, sa dentition
aléatoire, son regard vide décrivent un
personnage morbide sans expression de
vie. Un fantôme fait de chair. Derrière,
un cube flottant entouré de silhouettes
est maintenu en suspens à l'aide de
pince à linge.
À l'arrière-plan, l'horizon est oblique.
Les habitations sont dans la pénombre,
un monde de biais à l'envers où tout
semble être préfabriqué, illusoire.
L'Algérie
est encore une terre interdite pour les
Harkis, une terre fantôme pour leurs
enfants.
D'ailleurs, le village ancestral a été
déserté depuis les années 90, période de
la décennie noire. 10 années pendant
lesquelles l'Algérie a saigné du
terrorisme.
Le 5 juillet 1962, jour de
l'indépendance de l'Algérie, le peuple
se pensait libre après le départ des
Français.
En réalité, rien n'allait vraiment
changer. Ceux qui prétendaient avoir
libéré le peuple du joug colonial allaient, au fil
du temps, finir par leur ressembler
en cultivant le mythe du peuple uni face
à l'oppresseur, en faisant porter le
poids de la trahison sur les Harkis.
"Pour des visites de Harkis, c'est
exactement comme si on demandait à un
français de la résistance de toucher la
main à un collabo."
La nouvelle Algérie jetait un voile sur
son propre passé comme pour mieux s'en
échapper.
Un pays fantôme agité par le spectre
d'un passé colonial qui ne passe pas
dont la mémoire s'est laissée emporter
perdue quelque part dans les méandres de
l'histoire.
Au premier plan, un carton orné de motif
est posé au sol. Son traitement
graphique nous indique qu'il s'agit là
de l'œuvre d'un enfant.
Une inscription annonce la nature de
l'objet, le trésor caché.
Dans le fond du tableau, l'ombre portée
d'une assemblée d'oiseaux nous en révèle
la présence.
Sur chacune des phases du carton
apparaissent les éléments de scène des
différents tableaux précédemment
abordés.
De la colonne antique aux impacts de
balle, le tableau nous montre à voir
l'envers du décor.
L'œil lui, ajouré en son centre est
placé sur la face supérieure du carton.
L'obscurité qui en émane nous invite à
plonger notre regard à l'intérieur de la
boîte, à l'endroit du monde imaginaire
de l'enfant.
Sur le carton, une feuille de figuier
semble provenir de l'arbre dont la
silhouette se dessine en arrière-plan.
La feuille du figuier représente la
Genèse, l'origine du monde. L'arbre en
symbolise le lien généalogique.
Le trésor caché représente ici la
mémoire. comme objet de transmission.
Les filles et fils de Harkis sont devenus
parents. La question de la transmission
se pose. Pour ces héritiers, l'histoire
des Harkis semble figée comme prise en
otage détenu à la frontière de deux
camps irréconciliables.
Le sort des pères s'érige alors comme
un écran opaque, occultant un passé
encore plus lointain.
Derrière cet écran se cache toute une
histoire. celle de plusieurs générations
d'hommes et de femmes dont le parcours
singulier s'est laissé traverser par des
rêves, par des croyances.
Un parcours fait de combat, d'acte de
résistance porté par l'espoir d'un
avenir meilleur.
Aujourd'hui, à Dreux, au cœur de la cité royale,
l'histoire continue de s'écrire. Une
histoire où les destins des deux rives
ne cessent de se croiser, construisant
au fil du temps un chemin commun, un
chemin à la croisée des mémoires
nécessaire à la construction de ces
héritiers nécessaire à la transmission
pour les générations à venir.